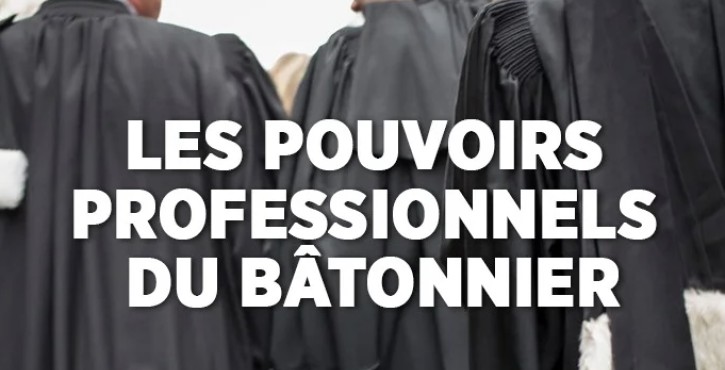1.   Liminaires
Â
Dans l’univers judiciaire francophone, le bâtonnier incarne l’autorité morale, administrative et disciplinaire de l’Ordre des avocats. En raison de ses nombreuses charges et engagements institutionnels, le bâtonnier bénéficie d’une reconnaissance traditionnelle qui se traduit par un privilège procédural implicite, celui de plaider « quand il peut » qui occupe une place particulière. Hérité d’une tradition de courtoisie confraternelle, ce principe attribue au bâtonnier une souplesse procédurale dans la gestion de ses affaires judiciaires, en reconnaissance du temps qu’il consacre à l’Ordre.  Ce principe, enraciné dans les traditions du barreau de la RDC, résonne comme une reconnaissance confraternelle du rôle institutionnel du bâtonnier. Mais à l’épreuve du droit processuel et des exigences déontologiques, il soulève des questions essentielles sur la légitimité de certains privilèges et les dérives observées dans la pratique. Cette note propose une analyse critique de ce principe à la lumière du droit positif, de la déontologie, et des pratiques observées dans les barreaux de la RDC.
Â
2.   Fondement et portée juridique du principe :  Le privilège d’audience
Â
Ce principe repose sur la coutume[1] juridique au sein des barreaux, notamment en RDC, où il est admis que le bâtonnier -  en tant que représentant de l’Ordre - puisse bénéficier d’un ordre de passage prioritaire lors des audiences que l’on appelle le privilège d’audience.  Il s’agit d’une marque de déférence confraternelle, dépourvue de toute force normative contraignante qui repose essentiellement sur un usage coutumier, non codifié par les textes juridiques. Toutefois, dans la pratique judiciaire, il est admis que le bâtonnier a un ordre de passage prioritaire à l’audience, en raison de son rôle institutionnel.
Â
Ainsi, lorsque le Bâtonnier se présente devant une juridiction, l’usage traditionnel du Barreau veut que son affaire soit appelée dès que possible. De même, lorsqu’il sollicite une remise du fait des fonctions de sa charge, l’usage veut que les Avocats adverses ne s’y opposent point. Cet usage s’applique aux Membres du Conseil de l’Ordre lorsque l’exercice d’une permanence le nécessite.
Â
L’acceptation de ce principe dépend alors de la courtoisie confraternelle entre avocats et de la souplesse du président d’audience, qui reste maître du déroulement des débats. Notons que ce principe ne doit pas entraver les droits de la défense ou créer une inégalité entre avocats. Ce principe n’est toutefois pas exempt de critiques.
Â
3.    Les critiques liées aux abus de procédure
Â
D’un point de vue déontologique, certains professionnels du droit estiment qu’il crée une hiérarchisation symbolique au sein du barreau. En effet, pour eux, accorder un privilège implicite au bâtonnier pourrait nuire au principe d’égalité entre confrères et renforcer une logique de pouvoir fondée davantage sur le statut que sur les compétences. Ce traitement préférentiel peut être perçu comme injuste par les jeunes avocats ou ceux issus de barreaux moins influents, d’autant plus que le bâtonnier n’est pas toujours en charge du dossier plaidé, mais intervient parfois à titre exceptionnel.
Â
En outre, le caractère non écrit de ce principe le rend fragile sur le plan juridique. En cas de conflit ou de contestation, il n’existe aucun fondement légal pour appuyer sa mise en œuvre, sauf se réfugier derrière le manquement fourre-tout d’indélicatesse. Cela soulève la question de sa légitimité, surtout dans une profession qui tend de plus en plus vers la transparence, l’impartialité et l’égalité des armes en justice.
Â
Ce privilège peut également perturber l’organisation des audiences, notamment lorsque le bâtonnier arrive tardivement ou sans prévenir, créant des tensions entre confrères soumis à des impératifs de temps. L’efficacité de la justice en pâtit parfois, surtout lorsque la souplesse demandée repose sur la seule bienveillance des autres avocats.
Â
Dans son discours moral du 2 décembre 2000, le bâtonnier MBUYI TSHIMBADI (Lubumbashi) pointait un affaiblissement de l’indépendance des avocats et un manque de loyauté vis-à -vis des règles implicites du barreau. Ces observations ont été reprises par le bâtonnier Jean-Claude MUYAMBO KYASSA dans Les Règles de la profession d’Avocat et les usages du Barreau de Lubumbashi (Éd. Mayambo & Associés, 2001). Il critiquait la perte d’indépendance vis-à -vis des clients, le mépris de la règle de déférence due au bâtonnier, et le manque d’élégance dans la pratique procédurale. En pratique, le principe « le bâtonnier plaide quand il peut » est parfois invoqué dans des conditions qui détournent son sens originel.
Â
Il arrive que des membres ou collaborateurs de cabinets de bâtonniers en exercice,  s’en prévalent, alors même que le bâtonnier n’est ni présent ni directement concerné par le dossier. Cette invocation abusive vise notamment à obtenir des remises ou reports d’audiences, créant une distorsion dans l’équilibre procédural entre confrères. Ce détournement de la règle, fondée sur la courtoisie et la reconnaissance institutionnelle, transforme un usage confraternel en instrument de faveur indue, au mépris de l’équité entre avocats. Ce comportement soulève des interrogations déontologiques sérieuses, car il repose sur une confusion entre la fonction du bâtonnier et les intérêts privés de son entourage professionnel.
Â
Au demeurant, ces situations nuisent à la crédibilité du barreau et remettent en question la légitimité du principe lorsqu’il est détourné à des fins stratégiques. Le bâtonnier devrait montrer l’exemple en sanctionnant les cas d’abus car, s’il est le bouclier de ses pairs, en revanche, il doit prendre garde à ne jamais devenir une couverture pour les confrères qui se fourvoieraient ou qui commettraient des fautes disciplinaires, selon les recommandations du Bâtonnier Pierre CHATEL qui aime dire « un bouclier : oui, une couverture : non ! »[2]
Â
4.    Entre coutume et droit : concilier souplesse institutionnelle et rigueur procédurale
Â
La profession d’avocat génère des usages séculaires qui, bien qu’issus de la coutume, ne sont pas dépourvus de portée normative. Le principe étudié ici en est une parfaite illustration. Il incarne la solidarité et la reconnaissance confraternelle, mais il ne doit pas être détourné de son objectif initial. Il convient donc de réfléchir à une régulation équilibrée qui préserve la souplesse accordée au bâtonnier tout en garantissant la loyauté procédurale. De ce fait, une charte des usages procéduraux pourrait être adoptée au sein de chaque barreau, précisant les cas stricts dans lesquels le principe peut être invoqué. L’usage du principe devrait être réservé au bâtonnier lui-même, et non à ses collaborateurs, sauf mandat explicite et documenté. Pour éviter des abus, les magistrats devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire en vérifiant la pertinence des demandes fondées sur ce principe.
Â
5.   Conclusion
Â
Le principe « le bâtonnier plaide quand il peut » témoigne d’une tradition respectueuse et confraternelle au sein des barreaux de la RDC. Il constitue une marque de reconnaissance de la fonction du bâtonnier au regard des charges importantes assumées par lui, au profit de la profession, fondée sur la courtoisie et la solidarité. Mais il doit être appliqué avec mesure et ne jamais être détourné à des fins procédurales contraires à l’esprit du droit.
Â
Si le bâtonnier mérite respect et souplesse dans l’exercice de ses fonctions, ce privilège symbolique ne doit jamais servir de levier d’iniquité entre confrères. Une régulation équilibrée, fondée sur la responsabilité, la transparence et l’éthique, permettra de préserver la dignité du barreau tout en garantissant l’égalité des armes aux prétoires. En fin de compte, la grandeur du bâtonnier ne réside pas dans les privilèges qu’il revendique, mais dans la noblesse de sa mission et la rigueur de son exemplarité.
Â
Me Joseph YAV KATSHUNG
[1] En droit, une coutume juridique est une règle de droit non écrite, issue de pratiques et d'usages constants et répétés au sein d'une société, et acceptée comme étant obligatoire. Elle repose sur deux éléments essentiels : un élément matériel (la répétition d'un comportement) et un élément psychologique (la conviction que ce comportement est juridiquement obligatoire). La coutume peut être une source de droit, mais elle ne doit pas contredire la loi.Â
Â
[2] Thierry GANGATE, « To be or not be Bâtonnier » (le leadership du Bâtonnier) in Le Journal des Bâtonniers et des Ordres, No 29, 2026
Â