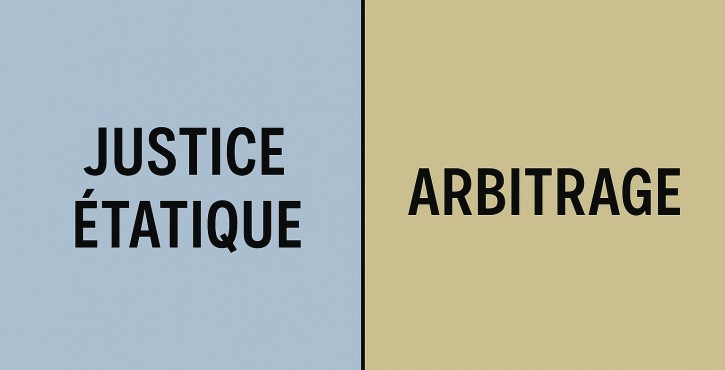Prof. Joseph YAV KATSHUNG[1]
I. Liminaires
L’arbitrage, en tant que mode alternatif de règlement des différends, repose sur une promesse fondamentale : offrir aux parties une procédure souple, confidentielle et adaptée à leurs besoins, tout en garantissant une certaine autonomie vis-à -vis des juridictions étatiques. Toutefois, cette autonomie n’est ni absolue ni hermétique. L’intervention judiciaire, bien que souvent perçue comme une ingérence, joue un rôle crucial dans la consolidation de la justice procédurale en arbitrage. Il convient dès lors de réévaluer les frontières entre l’intervention des juges étatiques et le respect des principes fondamentaux du procès équitable dans le cadre arbitral.
Traditionnellement, la doctrine distingue entre l’intervention judiciaire favorable à l’arbitrage - telle que l’appui à la constitution du tribunal arbitral ou l’exécution des mesures provisoires - et celle qui pourrait en compromettre l’efficacité, notamment par des contrôles excessifs ou des annulations arbitraires de sentences. Cette dichotomie, bien qu’utile, tend à simplifier une réalité plus nuancée. En effet, la justice procédurale ne se limite pas à la rapidité ou à la flexibilité de la procédure, mais englobe des garanties essentielles telles que le droit à un traitement équitable, le respect du contradictoire et l’impartialité du tribunal.
Dans ce contexte, l’intervention judiciaire peut être envisagée non pas comme une menace à l’autonomie de l’arbitrage, mais comme un mécanisme de sauvegarde des droits fondamentaux des parties. Par exemple, lorsque le tribunal arbitral est constitué dans des conditions entachées de partialité ou lorsque l’une des parties est manifestement privée de son droit à être entendue, le juge étatique devient le garant ultime de la justice procédurale. Refuser toute intervention dans de tels cas reviendrait à consacrer une forme d’arbitraire sous couvert d’autonomie.
Cependant, cette fonction de régulation judiciaire doit être exercée avec retenue et discernement. Une intervention trop intrusive risque de dénaturer l’esprit même de l’arbitrage, en le soumettant aux lourdeurs et aux incertitudes du contentieux étatique. C’est pourquoi plusieurs législations encadrent strictement les cas dans lesquels le juge peut intervenir, tout en laissant une marge d’appréciation suffisante pour préserver l’équilibre entre efficacité et équité.
La réévaluation des frontières entre justice étatique et arbitrage ne saurait donc se limiter à une opposition binaire. Elle appelle une approche fonctionnelle, fondée sur les exigences concrètes de justice procédurale. Il ne s’agit pas de restaurer une tutelle judiciaire sur l’arbitrage, mais de reconnaître que l’autonomie procédurale ne peut se construire au détriment des droits fondamentaux. En ce sens, le juge n’est pas un intrus, mais un partenaire silencieux, dont l’intervention ponctuelle permet de renforcer la légitimité du processus arbitral.
En définitive, la question n’est pas de savoir s’il faut plus ou moins d’intervention judiciaire, mais de déterminer dans quelles conditions et selon quels critères cette intervention peut contribuer à une justice procédurale authentique. C’est à cette condition que l’arbitrage pourra continuer à évoluer comme un espace de justice autonome, mais non déconnecté des principes fondamentaux du droit. Cela est d’autant vrai que l’arbitrage, s’est imposé comme une alternative crédible à la justice étatique, notamment dans les litiges commerciaux internationaux. Il repose sur des principes d’autonomie[2], de confidentialité[3] et de célérité[4]. Toutefois, cette autonomie procédurale ne saurait se concevoir en dehors des exigences fondamentales de justice procédurale, telles que le respect du contradictoire[5], l’égalité des armes[6], l’impartialité du tribunal[7] et le droit à une audience équitable[8].
Dans les espaces juridiques régis par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (Chambre de Commerce Internationale)[9] et par l’OHADA[10], ces exigences prennent des formes distinctes mais convergentes. Tandis que la CCI développe une pratique institutionnelle fondée sur le contrôle interne des sentences et la supervision procédurale, l’OHADA, à travers son Acte uniforme sur l’arbitrage et la jurisprudence de la CCJA, propose un modèle hybride où le juge étatique conserve un rôle de garant procédural. Cette étude propose une lecture croisée des pratiques de la CCI et de l’OHADA en matière de justice procédurale, afin de mettre en lumière les convergences, les tensions et les perspectives d’harmonisation dans les systèmes africains francophones.
II. Les fondements de la justice procédurale en arbitrage, entre autonomie et garanties fondamentales.
La justice procédurale en arbitrage repose sur un équilibre délicat entre la liberté des parties et le respect des principes fondamentaux du procès équitable. L’article 19 du Règlement d’arbitrage de la CCI permet aux parties de déterminer les règles de procédure, tout en imposant le respect du contradictoire et de l’égalité des parties[11]. De même, l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA sur l’arbitrage consacre la liberté procédurale, sous réserve du respect des droits de la défense[12].
Cette autonomie est cependant encadrée par des mécanismes de contrôle. À la CCI, le processus d’examen préalable ou « scrutiny » en anglais des sentences (article 34) permet à la Cour de vérifier que la décision arbitrale respecte les standards procéduraux minimaux[13]. Dans l’espace OHADA, la CCJA exerce un contrôle juridictionnel sur les sentences arbitrales, notamment en matière d’annulation pour violation du contradictoire ou de l’ordre public[14].
La jurisprudence internationale, comme dans l’affaire Methanex Corporation v. United States of America, rappelle que même dans un cadre arbitral, les principes de justice naturelle doivent être respectés[15]. Cette exigence est également présente dans la jurisprudence de la CCJA, qui a annulé des sentences pour défaut d’impartialité ou violation du contradictoire[16].
III. La pratique de la CCI, une justice procédurale institutionnalisée
En matière d’arbitrage institutionnel (interne ou international), certaines institutions d’arbitrage prévoient dans leur règlement d’arbitrage que le tribunal arbitral lui soumet d’abord un projet de sentence arbitrale sur lequel l’institution va exercer une revue et un contrôle. Cette exigence de contrôle préalable constitue une condition de validité de la sentence. Autrement dit, ce n’est qu’une fois que le projet de sentence est validé ou confirmé par l’institution qu’il constitue la sentence proprement dite qui peut alors être notifiée aux parties. Ainsi, la CCI se distingue par une approche institutionnelle de la justice procédurale. Le contrôle exercé par la Cour sur les sentences arbitrales, avant leur notification aux parties, vise à garantir la cohérence, la clarté et le respect des principes fondamentaux. Ce mécanisme, bien que non juridictionnel, constitue une forme de régulation procédurale interne. Si le contrôle du projet de sentence est une caractéristique courante dans les règlements d’arbitrage institutionnel, le contrôle prévu par le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) est probablement l’exemple le plus topique compte tenu de sa sophistication et de son étendue.
Par ailleurs, la CCI encourage la transparence et l’équité à travers des lignes directrices sur la conduite des arbitres, la gestion des conflits d’intérêts et la communication des preuves[17]. Le Guide de l’arbitre de la CCI insiste sur l’obligation d’impartialité et d’indépendance, ainsi que sur le respect du contradictoire[18].
La jurisprudence arbitrale sous l’égide de la CCI montre une sensibilité croissante aux enjeux procéduraux. Dans l’affaire ICC Case No. 12345, le tribunal arbitral a été critiqué pour avoir statué sans permettre à l’une des parties de répondre à des éléments nouveaux, ce qui a conduit à une révision de la sentence par la Cour[19].
Â
IV. La justice procédurale dans l’espace OHADA, entre contrôle judiciaire et arbitrage institutionnel
L’OHADA propose un modèle hybride, où l’arbitrage est encadré par des règles uniformes mais reste soumis à l’intervention du juge étatique. L’article 13 de l’Acte uniforme permet au juge de nommer un arbitre en cas de défaillance, tandis que l’article 25 prévoit l’annulation de la sentence en cas de violation du contradictoire ou de l’ordre public[20].
La CCJA joue un rôle central dans la régulation de la justice procédurale. Dans l’affaire CMA CGM c. SNPC, la Cour a annulé une sentence pour défaut de communication des pièces à l’une des parties, consacrant ainsi le principe du contradictoire comme norme impérative[21].
V. Conclusion
La justice procédurale en arbitrage ne saurait être reléguée au second plan sous prétexte d’efficacité ou de confidentialité. Elle constitue le socle sur lequel repose la légitimité du processus arbitral. La lecture croisée des pratiques de la CCI et de l’OHADA révèle une convergence vers une régulation équilibrée, où l’autonomie des parties est respectée, mais encadrée par des mécanismes institutionnels ou juridictionnels visant à garantir l’équité.
Dans les systèmes africains comme en RDC, cette dynamique offre des perspectives d’harmonisation et de consolidation de la justice procédurale, notamment par le renforcement du rôle de la CCJA, l’amélioration des pratiques arbitrales locales, et l’intégration des standards internationaux. L’arbitrage ne peut être un espace de justice sans juge, mais il peut devenir un espace de justice avec des juges en retrait, garants silencieux de l’équité procédurale.
Â
[1] Professeur des UniversitĂ©s, Avocat aux Barreaux de Kinshasa Matete, Haut – Katanga et Lualaba, Fondateur du Cabinet YAV & ASSOCIATES; Arbitre AgrĂ©Ă© auprès du Centre d’Arbitrage, de MĂ©diation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) , Mandataire AgrĂ©Ă© en PropriĂ©tĂ© Industrielle et Membre du comitĂ© de l’AIFOD [Artificial Intelligence for Developing Countries Forum]. CertifiĂ©Â de l’ACADÉMIE ARBITRAGE INTERNATIONAL du  Collège de Paris et de l’ICC Advanced Arbitration Academy for Africa 2024-2025. Â
Â
[2] L’autonomie signifie que les parties ont une grande libertĂ© pour organiser la procĂ©dure arbitrale. Elles peuvent choisir l’arbitre, dĂ©finir les règles de procĂ©dure, et mĂŞme la loi applicable au fond du litige. Cette autonomie renforce la flexibilitĂ© de l’arbitrage et permet aux parties de l’adapter Ă leurs besoins spĂ©cifiques.Â
[3] La confidentialitĂ© est un aspect essentiel de l’arbitrage, protĂ©geant les parties contre la divulgation publique des informations relatives au litige et de la dĂ©cision rendue. En gĂ©nĂ©ral, les audiences d’arbitrage sont privĂ©es, et les parties s’engagent Ă ne pas divulguer les informations obtenues lors de la procĂ©dure. Cette confidentialitĂ© est particulièrement importante dans le contexte des affaires, oĂą la divulgation d'informations sensibles peut nuire Ă la rĂ©putation ou aux intĂ©rĂŞts commerciaux des parties.Â
[4] L’arbitrage est souvent perçu comme une procĂ©dure plus rapide que les litiges devant les tribunaux Ă©tatiques. Cette cĂ©lĂ©ritĂ© s’explique par la possibilitĂ© pour les parties de simplifier la procĂ©dure, de choisir des arbitres expĂ©rimentĂ©s, et d’éviter les voies de recours longues et complexes. Cependant, il est important de noter que la cĂ©lĂ©ritĂ© n’est pas garantie et dĂ©pendra de la complexitĂ© du litige et de la volontĂ© des parties de coopĂ©rer.Â
[5] Chaque partie a le droit de connaĂ®tre et de rĂ©pondre aux arguments, preuves et allĂ©gations de l’autre partie. Cela implique une communication ouverte et transparente entre les parties et le tribunal arbitral.Â
[6] Les parties doivent ĂŞtre traitĂ©es de manière Ă©gale tout au long de la procĂ©dure. Elles doivent avoir les mĂŞmes droits et les mĂŞmes opportunitĂ©s pour prĂ©senter leur cas, produire des preuves et se dĂ©fendre.Â
[7] Le tribunal arbitral doit ĂŞtre indĂ©pendant et impartial, sans parti pris pour aucune des parties. Les arbitres doivent agir de manière objective et neutre, en se basant uniquement sur les faits et les preuves prĂ©sentĂ©es.Â
[8] Les parties ont le droit de prĂ©senter leur cause devant un tribunal qui respecte les principes d’une procĂ©dure Ă©quitable. Cela comprend le droit Ă une audience, le droit Ă ĂŞtre entendu et le droit Ă un jugement motivĂ©.Â
[9] La Cour internationale d’arbitrage a fourni des services pendant plus de 23,000 cas d’arbitrage depuis sa création en 1923. C’est est un organisme indépendant et autonome, faisant partie de la Chambre de commerce internationale (le «ICC»), la plus grande organisation commerciale du monde, avec son siège à Paris, France. La Cour internationale d’arbitrage, bien qu’on l'appelle «la Cour», n’est pas un organe judiciaire et ne rend pas lui-même de jugement sur les aspects de fond des questions litigieuses. Selon son statut, son rôle principal est d’assurer le contrôle des procédures d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CCI, avec son rôle, y compris l’examen et l’approbation des sentences arbitrales. Voir : https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/
[10] Il sied de différencier ce que l’on entend par l’arbitrage OHADA et l’arbitrage CCJA pour éviter des confusions. L’Arbitrage OHADA est celui qui est régi par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage (AU/DA). Il ne s’agit pas nécessairement d’une forme d’arbitrage institutionnel. L’arbitrage CCJA, quant à lui, est celui qui fonctionne dans le cadre du centre permanent d’arbitrage qui fonctionne au sein de la CCJA. Celle-ci administre l’arbitrage et, à la différence des autres Centres d’Arbitrage, a des pouvoirs juridictionnels. Comme tout centre permanent d’arbitrage, la CCJA dispose d’un Règlement d’Arbitrage. Il convient de noter que cet arbitrage n’est pas régi par l’AU/DA. Il se distingue aussi par son champ spatial. En effet, il résulte des termes de l’article 21 du Traité OHADA que cet arbitrage n’est ouvert que dans le cas de litiges dont l’une des parties, au moins, a soit son domicile soit sa résidence habituelle dans un État partie à l’OHADA ; ou encore de litiges nés de contrats dont l’exécution se déroule, ou est prévue pour se dérouler, intégralement ou partiellement, sur le territoire d’un État partie. Cette limitation spatiale de l’arbitrage CCJA se comprend aisément car il est encadré, administré, par la CCJA et doit, donc, être circonscrit dans le champ de compétence territoriale de ladite Cour. Une autre originalité du système d’arbitrage institutionnel de la CCJA et qu’il se fonde sur une convention internationale, le Traité constitutif de l’OHADA. Finalement, le système d’arbitrage de la CCJA est totalement autonome et international.
[11] Règlement d’arbitrage de la CCI, édition 2021, art. 19.
[12] Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage, art. 10.
[13] Ibid., art. 34.
[14] Lire à ce sujet, Coco Kayudi, les modes alternatifs de règlement des conflits, in juriafrique.com, publié le 23 juillet 2017
[15] Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL, Final Award, 3 août 2005.
[16] CCJA, arrêt n° 001/2017 du 9 janvier 2017, Société X c. État Y.
[17] Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le règlement d’arbitrage CCI (2021)
Â
[18] Guide de l’arbitre de la CCI, édition 2020.
[19] ICC Case No. 12345, résumé doctrinal dans ICC Bulletin, vol. 30, n° 2, 2019.
[20] Acte uniforme OHADA, art. 13 et 25.
[21] CCJA, CMA CGM c. SNPC.
Â