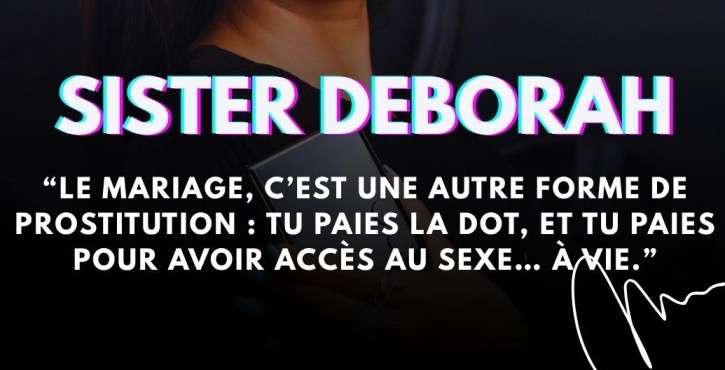Les faits: « Le mariage, c’est une autre forme de prostitution : tu paies la dot, et tu paies pour avoir accès au sexe… à vie. » Cette phrase, lancée par la chanteuse ghanéenne Sister Derby, a fait l’effet d’un séisme. Mais que voulait-elle dire, au fond ? Était-ce une provocation gratuite, une critique féministe, ou simplement une métaphore mal calibrée ?
Derrière sa brutalité rhétorique, elle soulève une question essentielle : la dot, dans certaines pratiques coutumières, ne devient-elle pas un mécanisme de marchandisation du corps féminin ? Et le mariage, censé être une alliance fondée sur le consentement et la dignité, ne glisse-t-il parfois vers une forme de servitude sexuelle légalisée ? Loin de se contenter d’une indignation morale ou d’une approbation militante, proposons une lecture critique et nuancée de cette déclaration, en croisant les perspectives juridiques, sociologiques et culturelles, notamment dans le contexte congolais.
En Droit : Dans de nombreuses cultures africaines, la dot est traditionnellement perçue comme un acte de respect envers la famille de la mariée, symbolisant l’alliance entre deux lignées. Elle est censée valoriser la femme et consacrer l’union. Toutefois, dans certaines pratiques contemporaines, notamment en RDC, cela prend parfois des allures de transaction commerciale. Les montants exigés peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars, accompagnés de listes de biens luxueux. Le futur époux, souvent jeune et sans ressources, s’endette ou renonce au mariage. La dot devient alors un investissement à haut risque, sans garantie de retour, surtout en cas de séparation rapide.
Paradoxalement, la mariée elle-même ne bénéficie souvent pas de cette dot. Celle-ci est captée par les membres de sa famille, qui l’utilisent à des fins personnelles. La femme, censée être honorée, devient un capital familial, une source de revenus indirects, sans autonomie ni pouvoir sur les fonds versés en son nom. Cette logique transforme parfois le lit conjugal en espace tarifé, où l’intimité se négocie et se contractualise.
En droit congolais, le mariage impose des obligations réciproques aux époux, notamment la cohabitation et le devoir conjugal. Le Code de la famille prévoit que les époux doivent vivre ensemble et contribuer aux charges du ménage, y compris par la vie commune et l’intimité physique. Le refus de cohabiter ou de remplir le devoir conjugal peut être invoqué comme motif de rupture du lien matrimonial. Dans ce contexte, la logique du « dû conjugal », héritée de la conception paulinienne de la dette sexuelle (1 Corinthiens 7:3-5), persiste dans certaines mentalités : « Tu as payé la dot, tu as droit à… » À quoi, exactement ? À une disponibilité sexuelle ? À une exclusivité tarifée ?
Ainsi, Sister Derby, dénonce ces dérives en assimilant certains mariages à une forme de prostitution institutionnalisée. Si cette lecture est provocatrice, elle met néanmoins en lumière une tension réelle entre le discours officiel sur la dot et certaines pratiques sociales où la femme est perçue comme un bien transmis. Toutefois, sur le plan juridique, ni le droit congolais ni le droit ghanéen ne reconnaissent la dot comme une contrepartie sexuelle. Elle demeure un acte coutumier, encadré par des normes sociales et familiales.
Car le mariage, dans sa version juridique, n’est pas une chambre louée à l’heure. C’est un engagement bilatéral, fondé sur le consentement, la solidarité, et parfois même l’amour (si, si, ça arrive). La dot, dans sa version coutumière, est censée symboliser le respect, l’alliance entre familles, et non l’achat d’un corps en libre-service. Et puis, soyons honnêtes, si le mariage était une forme de prostitution, alors les divorces seraient des ruptures de contrat commercial, les disputes conjugales des litiges de prestation, et les anniversaires de mariage des renouvellements d’abonnement.
Sister Derby, en réalité, ne parle pas du mariage dans sa noblesse juridique ou spirituelle. Elle parle du mariage dévoyé, celui où la femme devient un bien transmis, où le sexe devient une obligation, et où l’homme croit avoir acheté un droit à vie. Et sur ce point, elle n’a pas tort. Mais réduire tous les mariages à cette caricature, c’est comme dire que tous les restaurants servent de la nourriture avariée parce qu’on est tombé une fois sur un plat douteux.
Me Joseph YAV KATSHUNG