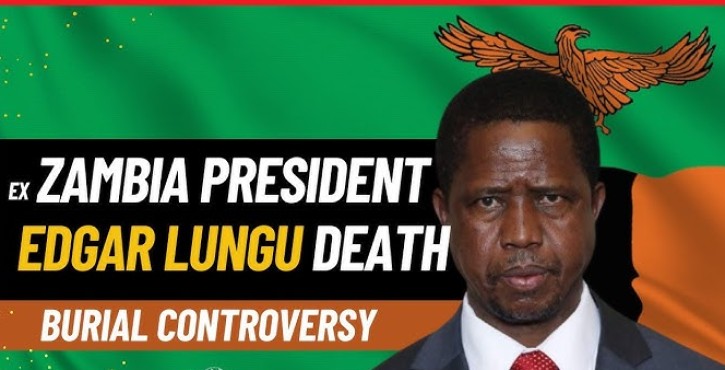Les faits : La mort d’un chef d’État ne clôt pas seulement une trajectoire politique, elle la déplace. Elle ouvre un espace de tensions juridiques, mémorielles et symboliques. Le décès, de l’ancien président de la Zambie Edgar Lungu, survenu le 5 juin 2025 à Johannesburg, a déclenché une querelle juridique peu banale ; l’État zambien, prompt à annoncer un deuil national et une inhumation au site réservé aux chefs d’État - s’est heurté à la volonté de la famille, qui préférait une cérémonie privée en Afrique du Sud. Un accord initial semblait sceller le rapatriement, mais le jour prévu, la famille fit volte-face. Le cercueil resta bloqué à Johannesburg, et le gouvernement saisit la Haute Cour de Pretoria.
Ce cas illustre avec acuité cette dialectique entre souveraineté funéraire et autonomie familiale, où le cadavre devient un objet de droit disputé, à la fois patrimoine national et bien familial. Ça mérite un deuxième regard en droit.
En Droit : Quel rôle joue le droit dans cette problématique ? La plupart du temps, aucun. Tant qu’il n’y a pas de contentieux entre les survivants, tant que les formes élémentaires de la police des funérailles et de l’ordre public ne sont pas transgressées, le droit reste muet. Mais, dès lors qu’un différend se fait jour entre les survivants, le droit entre en scène. Sur quels principes se fonde-t-il pour arbitrer ce genre de conflits et qu’est-ce que le cadavre pour le droit ? Cent ans plus tôt, M. Planiol (1899) publiait : « Les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien ». A la rigueur, le cadavre serait une chose, mais une chose dont il reste à définir le régime et le Code civil dispose que le cadavre est une chose hors-commerce, qu’il est incessible et indisponible.
En somme, saisie entre l’artefact juridique (le sujet de droit) et la réalité simple (les « restes »), la dépouille humaine n’a guère de place en tant que telle dans la doctrine. Elle n’est que « le substrat matériel d’une ex-personne ». Reste que cette ex-personne garde partiellement autorité, par voie testamentaire, sur le sort qui est réservé à sa dépouille qui est protégée par des principes de dignité, de respect et de volonté testamentaire.
Mais lorsque le défunt est un ancien chef d’État, le corps acquiert une valeur symbolique qui dépasse le droit privé. Il devient un bien mémoriel, un vecteur de légitimation politique, un objet de protocole étatique. Dans le cas Lungu, les tensions entre la famille et l’État ont révélé une zone grise juridique : qui décide du lieu d’inhumation ? Qui organise les rites ? Qui parle au nom du défunt ? Le droit coutumier, souvent invoqué par les proches, entre en collision avec les impératifs de représentation nationale. Le cadavre devient alors un champ de compétence concurrente, où la souveraineté étatique prétend primer sur l’autonomie familiale. Face à l’absence de cadre juridique clair, les litiges post-mortem se déplacent vers la justice.
Le cas Lungu n’échappe pas à cette logique : la famille revendique un droit de contrôle sur les funérailles, tandis que l’État invoque l’intérêt national et le protocole républicain. La Haute Cour de Pretoria saisie, conclut que l’ancien président demeurait domicilié en Zambie au moment de son décès. Elle reconnut que, selon le droit public zambien, l’État détient un droit supérieur sur les modalités funéraires d’un ancien président. Même les volontés du défunt ou de sa famille doivent céder devant l’intérêt national et ordonna la restitution du corps à l’État zambien. Cette décision repose sur une conception républicaine du cadavre présidentiel comme bien public, analogue à celle développée dans certaines juridictions européennes (cf. Re Blagdon Cemetery [2002] 3 WLR 603).
Mais la décision est suspendue en appel, et le corps demeure sous haute surveillance en Afrique du Sud. Au finish, il fut un temps où mourir suffisait à clore un mandat. Aujourd’hui, c’est le début d’un nouveau contentieux. Le président défunt n’est plus un corps à enterrer, mais un dossier à instruire. Sa tombe devient un banc de juridiction, son cercueil un acte administratif, et sa mémoire un champ de bataille entre le droit, la famille, et l’État, ce dernier n’ayant jamais su s’il gouvernait les vivants ou les symboles. Le corps du chef d’État, jadis sacré, est désormais un bien litigieux. Le droit, lui, observe en silence. Il n’a jamais prévu qu’un cadavre puisse être à la fois patrimoine national et bien familial. La situation serait pire en RDC, où le droit funéraire est encore orphelin !
Me Joseph YAV KATSHUNG